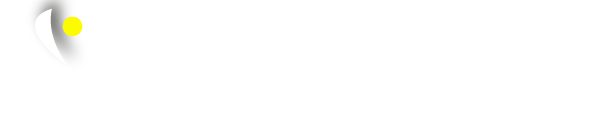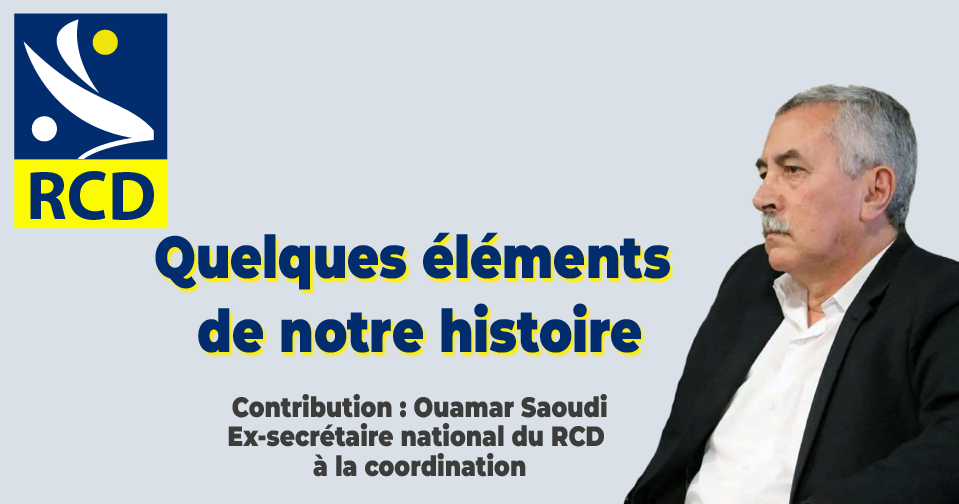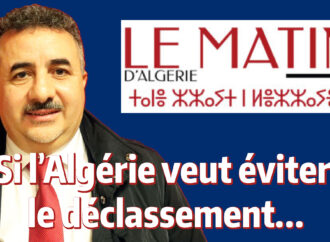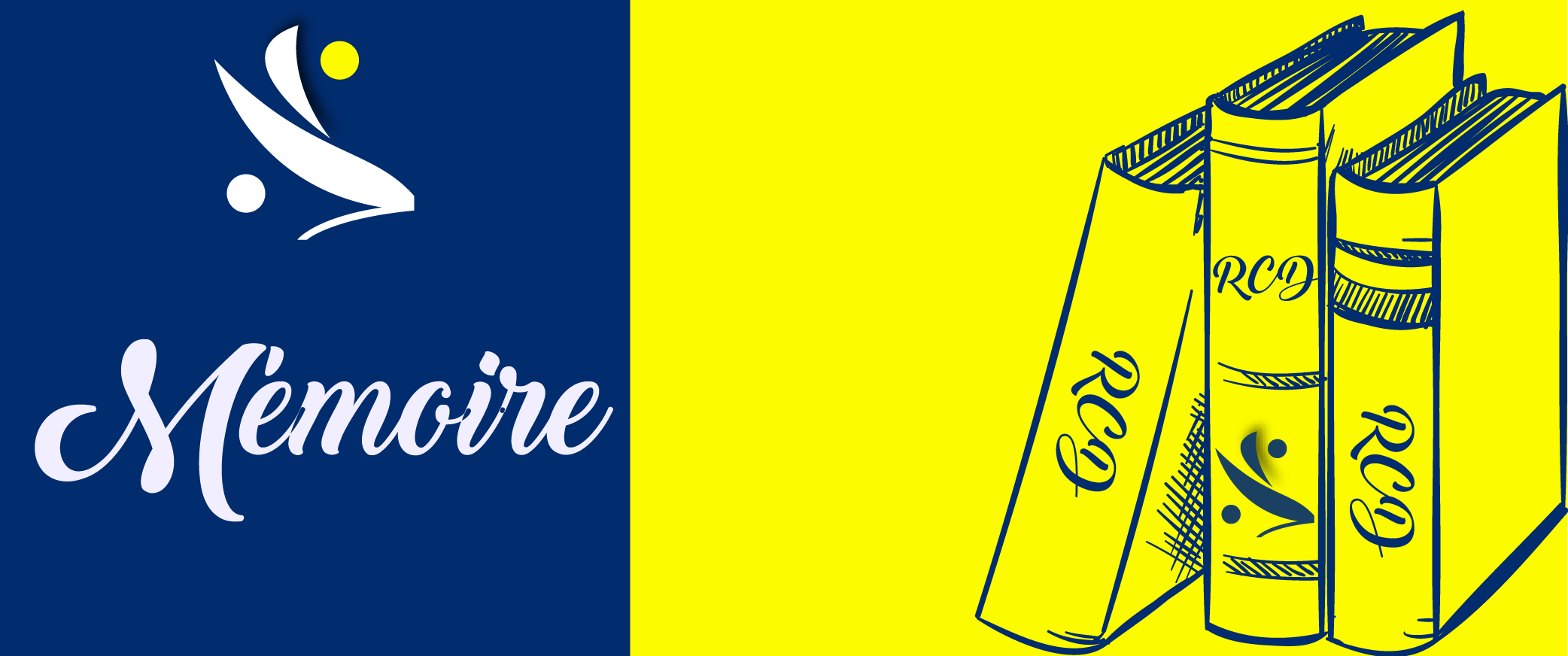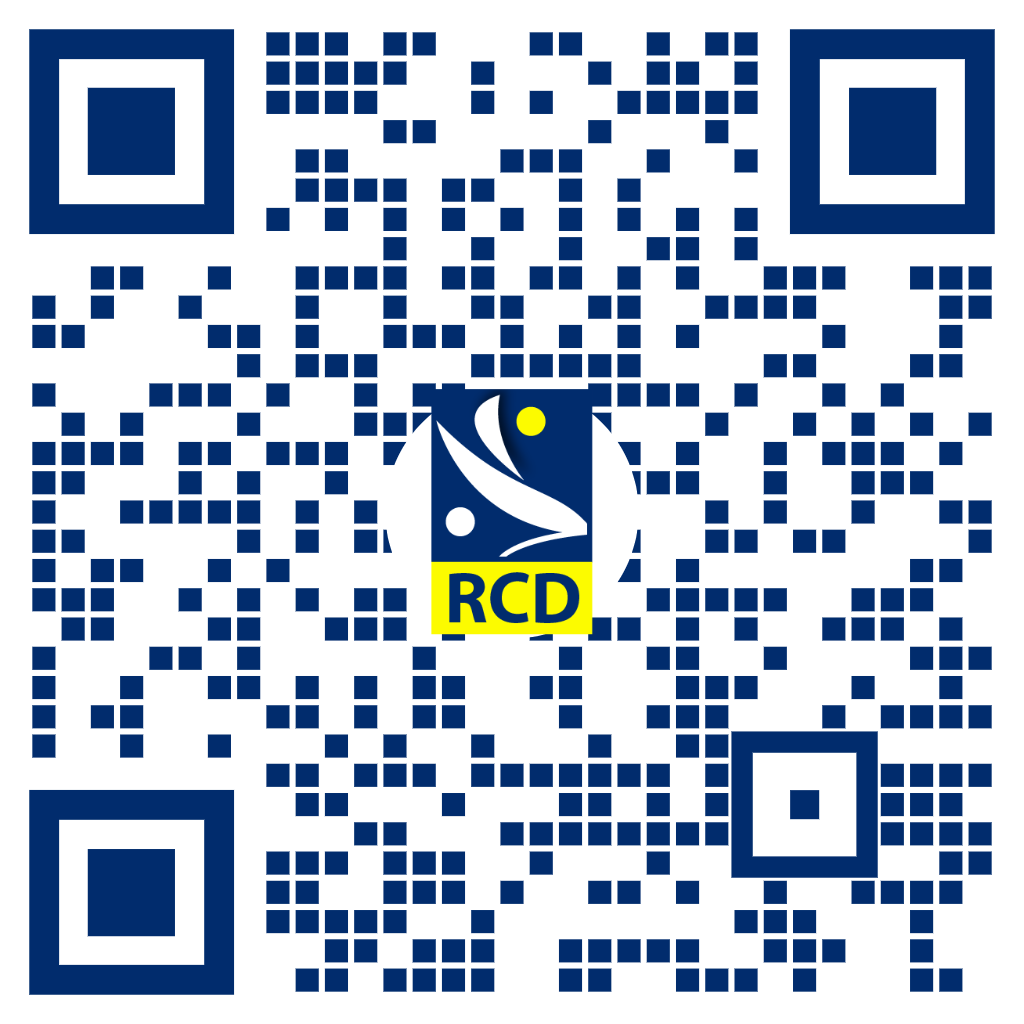Cet écrit est destiné à contribuer à des clarifications que j’espère utiles, maintenant que les luttes pour le contrôle du parti, lors du mouvement de février 2019, sont assumées par le biais de divergences politiques. Sont-elles vraies ou inventées après coup, pour des besoins mercantiles. Cela ne change rien.
Certaines de ces divergences relèvent de l’orientation stratégique du parti après son troisième congrès, d’autres procèdent de prises de position de nature tactique, voire opportuniste.
Il s’agit de contribuer à lever les confusions, sources d’émergence de médiocrités et d’opportunismes. C’est d’ailleurs ce que veut soutenir un ancien militant et cadre du RCD, auteur d’un procès en règle contre le RCD dans son intervention sur les réseaux sociaux le 21 mai 2025.
Dans ce texte, et pour une question de méthodologie, je n’aborderai que la période où je fus secrétaire national à la coordination (cette mission a pris fin lors du sixième congrès du parti en juin 2022) et celle qui l’avait précédée.
Plateforme pour le changement en Algérie datée du 15 mars 2019
La signature de cette plateforme par l’ex-président du RCD est devenue un véritable bourourou aux yeux des détracteurs de l’orientation du parti. Elle est donc érigée en trahison suprême par une sorte de tribunal censitaire.
En plus d’avoir en horreur l’autocritique stalinienne exercée dans les Partkom, j’assume personnellement ce texte dans son fond, sa justesse dans le contexte, son actualité brûlante et son prolongement dans l’orientation du parti, cristallisée dans la plateforme de transition adoptée à la conférence de Mazafran, le 10 juin 2014, à l’initiative de la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique (CNLTD). J’aggrave donc le score aux jeux de ceux qui pensent détenir ou découvrir un cadavre dans le placard.
Sur le contenu de la plateforme
Ce texte comprend trois parties:
· Le contexte du soulèvement de 2019 est au centre avec la revendication d’une « Algérie libre et démocratique » comme principal slogan des manifestations à travers le pays ;
· Les objectifs à atteindre, dont la souveraineté du pays et le droit de tous les citoyens d’y vivre libres et dignes, le suffrage universel comme seul moyen de choix des dirigeants et des programmes politiques, les libertés individuelles et collectives, le contrôle démocratique effectif des forces armées et des services de sécurité ;
· La feuille de route ou les actions qui passent par la démission du chef de l’État à l’issue de son mandat le 27 avril 2019, la démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres. Enfin, une Présidence collégiale, l’ouverture et l’organisation de la transition à travers un débat général (processus constituant).
À ma connaissance, et jusque-là, personne n’a émis la moindre critique sur le contenu du document qui, au demeurant, est public.
Sur la démarche
Le fait que Mourad Dhina signe ce texte en compagnie d’autres activistes ou militants, à l’instar de l’ex-président du RCD, durant cette période diffère-t-il de la présence des islamistes à la conférence de Mazafran ? Je rappelle qu’à Mazafran, président du parti d’alors, l’ensemble des cadres et de l’encadrement du RCD ont adopté les documents de ce rendez-vous, tout comme Ali Belhadj et Kamal Guemazi.
Qu’est-ce qui a donc changé pour qu’on décrète, cinq ans après cet événement majeur de la vie politique nationale, une interdiction aux militants du parti de mettre leur nom à côté des dirigeants de l’ex-FIS dans un texte qui appelle au respect des libertés et des droits de l’Homme, à l’ouverture des champs politiques et médiatiques, à l’organisation d’une période de transition pour donner la parole au peuple algérien dans un processus défini par l’ensemble des forces politiques du pays, et qui prône un contrôle démocratique sur les institutions de sécurité ? Il serait utile pour tous de relire la feuille de route du RCD dévoilée le 27 mars 2019 lors d’une conférence de presse. L’orientation de la transition démocratique demeure et doit demeurer l’aiguillon stratégique de la politique du parti jusqu’au prochain congrès.
Quant aux aspects tactiques de la mise en œuvre de la transition, ils sont souvent tributaires de la situation politique objective aux échelons national et international. La construction d’un regroupement des démocrates (le facteur subjectif de la situation politique) doit demeurer une constante pour bâtir le seul outil garantissant un poids idoine des forces démocratiques dans la négociation en vue de cette transition, lorsque les conditions objectives sont réunies, comme ce fut le cas en 2019. Je pense qu’un débat sans diktats sur cette construction peut être organisé utilement.
La question vient naturellement à l’esprit est la suivante : une transition démocratique peut-elle être viable sans un processus de vérité et justice sur les massacres, les assassinats et les disparitions forcées des années 1990 ? La réponse est NON. Pour rappel, c’est la charte dite pour « la paix et la réconciliation nationale », imposée lors d’un référendum le 29 septembre 2005 par l’ancien chef de l’État, A. Bouteflika, qui criminalise toute tentative de recherche de la vérité sur la tragédie des années 90. Le RCD, à travers une déclaration de septembre 2005, avait dénoncé ce texte qui institue l’oubli et l’amnésie, mutile la mémoire collective et sème les germes de conflits futurs.
Dans la résolution du Conseil national du RCD, en date du 8 juillet 2005, on lit « Dans le cas de notre pays, des responsables politiques dignes de ce nom se devaient d’assumer et de consolider les acquis démocratiques arrachés par le peuple, d’honorer une résistance citoyenne exemplaire et d’assumer les abus des commis de l’État mis devant des situations intenables et inédites. ». Cette ligne de « vérité et justice » est largement défendu dans la revue Tafsut que nous publions dans cette période.
La question n’est pas morale ou seulement morale. En Afrique du Sud, où les Noirs étaient victimes d’un racisme d’État pendant plus de quarante ans, avec son lot de milliers de victimes, d’emprisonnements arbitraires, d’humiliations… l’ANC, tentée un temps par l’amnistie générale, s’est ravisée pour opter pour une amnistie conditionnée à travers les commissions vérité et justice.
Construire la mémoire des conflits est l’unique moyen d’en prévenir d’autres. Cela est d’autant plus urgent que les acteurs et les témoins du drame ont aujourd’hui plus de quarante ans. Œuvrer pour une Algérie apaisée, démocratique et sociale implique des efforts de tous, loin des lieux communs et des fanfaronnades, pour restituer au pays toute sa mémoire. Car, de tout temps, l’aspiration à la liberté et à la justice a été la boussole des luttes de notre peuple.
Refus de retrait de l’Assemblée en 2019
Les députés du RCD qui ont démissionné de l’APN en octobre 2019, huit mois après le déclenchement des manifestations en février, n’étaient pas les premiers à s’incruster dans cette démarche. D’autres ont inauguré ce retrait dès avril 2019.
Je n’ai pas aucunement intention de discuter les raisons avancées dans l’intervention du 21 mai 2025. Cependant, il est de notoriété publique que plusieurs démissions ont été enregistrées après la fameuse réunion du 30 mars 2019. Je ne peux m’étaler sur les circonstances de cette réunion, encore moins sur les suites qui en ont découlé, pour des raisons évidentes de conjoncture et la justice a statué à deux reprises sur cet épisode. Le plan élaboré consistait à traiter la crise par le biais d’une nouvelle Assemblée, pour épargner la présidence de Bouteflika.
Dès lors, il devient évident que la meilleure campagne électorale était le retrait, pour se présenter comme le meilleur opposant. Les reconversions de nombreux acteurs politiques au mot d’ordre de l’Assemblée constituante laissent toujours pantois, car jusque-là, ils estimaient qu’une telle élection donnerait, à coup sûr, une majorité aux islamistes. Le risque n’est effectivement pas nul.
Pour le parti, qui ne partage pas cette démarche (voir notre feuille de route), le processus constituant ne peut démarrer par une élection de ce type sans être précédé de préalables sur la liberté de conscience, la séparation du religieux et du politique (laïcité), les libertés fondamentales, la question linguistique, les modalités d’accès au pouvoir et l’alternance démocratique. Ces préalables ne peuvent être confiés à une Assemblée qui risque effectivement d’être dominée par les islamistes et leurs alliés conservateurs.
Il s’agit pour nous de peser pour garantir les libertés et l’alternance démocratique avant de procéder à toute élection. C’est le sens de l’initiative du Pacte pour l’Alternative Démocratique (PAD).
L’histoire du groupe de pression
L’auteur de l’intervention s’offusque que la direction du RCD ait, en ce temps-là, usé du terme « groupe de pression » dans l’une de ses déclarations pour défendre son orientation dans un contexte d’extrême adversité. Pour rappel, le RCD, dans un communiqué daté du 18 octobre 2019, déclarait : « Le RCD… est la cible d’une déstabilisation par ceux qui conçoivent le parti comme un simple groupe de pression. »
Lors du cinquième congrès du parti, une question quelque peu introduite en tapinois a divisé les congressistes : celle du changement de sigle. Les arguments affichés par les partisans du changement étaient qu’il fallait passer à une autre étape pour rassembler les progressistes à l’échelle nationale (le nouveau sigle proposé était « Les Progressistes » ; dans les faits, ce changement signifiait qu’il fallait passer d’un parti qui fait pression ou influence le pouvoir et les institutions à un parti qui aspire à exercer le pouvoir. Ceux qui refusaient cette proposition (majoritaires) estimaient qu’il aurait fallu avoir un débat dans les pré congrès (pas de désaccord de fond dans l’argumentation).
Étant président du congrès et, après que cette proposition avait été repoussée, j’ai fait ce que j’ai pu pour qu’une résolution soit adoptée afin de reprendre ce débat sereinement dans les nouvelles instances du parti. En vain : les uns étaient démobilisés par la « défaite » et les autres, grisés par la « victoire », voulaient rester totalement libres tout au long d’un nouveau mandat.
J’estime que les manifestations populaires en 2019 et notre popularité dans la rue nous ouvraient la voie à devenir un véritable parti national, tout en consolidant nos fiefs historiques. Les arguments à la carte ne peuvent faire avancer notre cause commune : construire un outil capable d’influer durablement sur le cours des événements.
Au demeurant, le bilan moral et politique de cette gestion a été adopté sans réserve par le sixième congrès du parti, tenu en juin 2022.
Je ne peux terminer cette contribution sans dénoncer et condamner les attaques dont est victime Atmane Mazouz en tant que président du RCD. L’instance présidentielle du parti n’est sous le contrôle que des militants du parti à travers les structures statutaires du Rassemblement. Dans ce cas d’espèce, le Conseil national, en attendant la tenue du congrès statutaire.
Pourtant, les auteurs de ces jugements savent que les invectives et les attaques personnelles venues de l’extérieur produisent immanquablement, chez les militants, un patriotisme de parti pour resserrer les rangs autour de la direction légitime.
Enfin, il faut croire que l’objectif recherché n’est ni un “redressement” ni une récupération, mais le discrédit et la dislocation pour laisser place… À quoi ? C’est la question.
Cette question prend tout son sens au moment où les menaces sur le multipartisme ne relèvent plus de la spéculation. Une fois promulguée, la nouvelle loi sur les partis comporte des exigences difficilement surmontables pour une organisation qui aspire à être ou à demeurer autonome.
C’est ma contribution pour apporter des clarifications à ceux qui se posent sincèrement les questions que j’ai abordées. Je n’ai nullement l’intention d’entretenir une quelconque polémique en rappelant des faits vérifiables.
Alger, le 27 mai 2025
Ouamar Saoudi
Ex-secrétaire national du RCD à la coordination