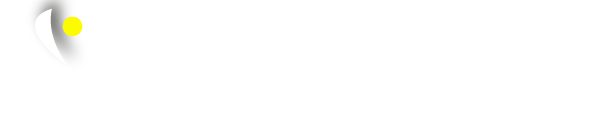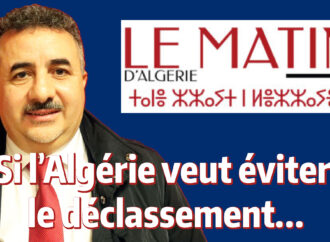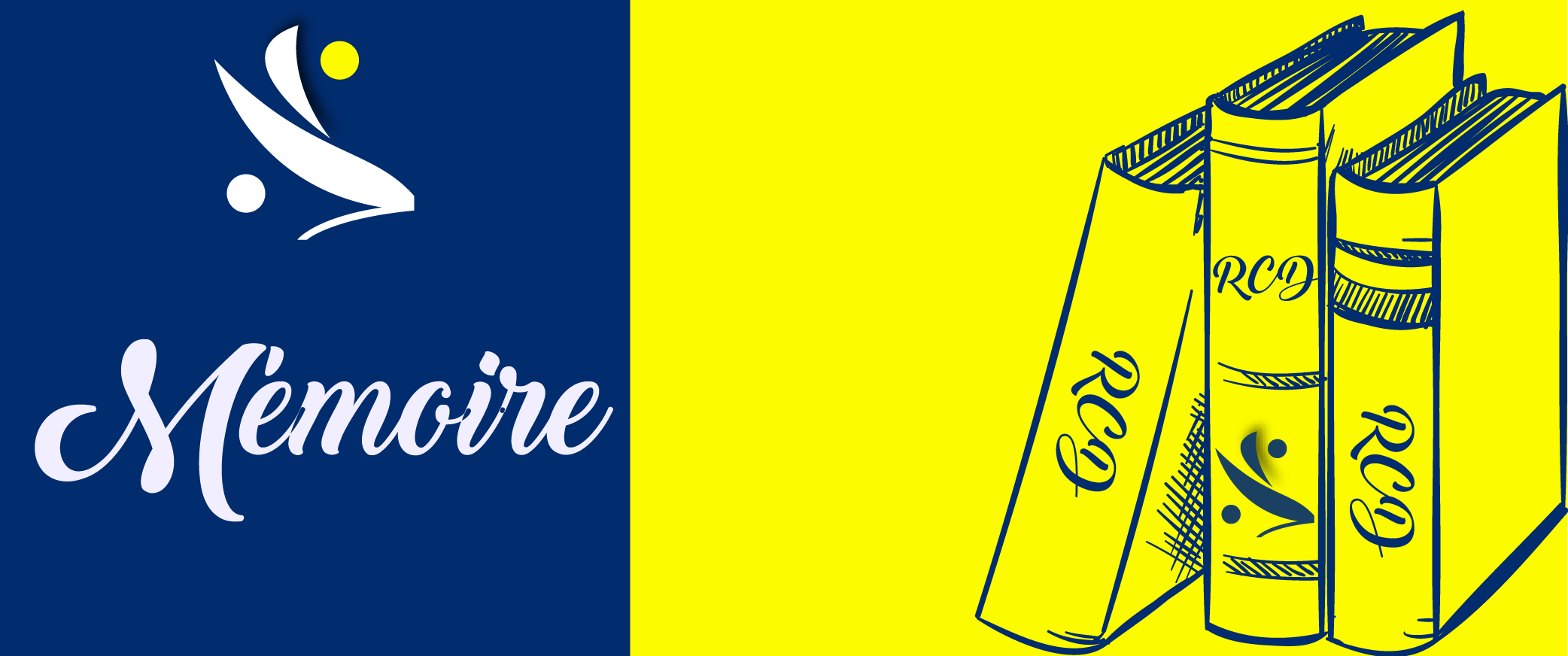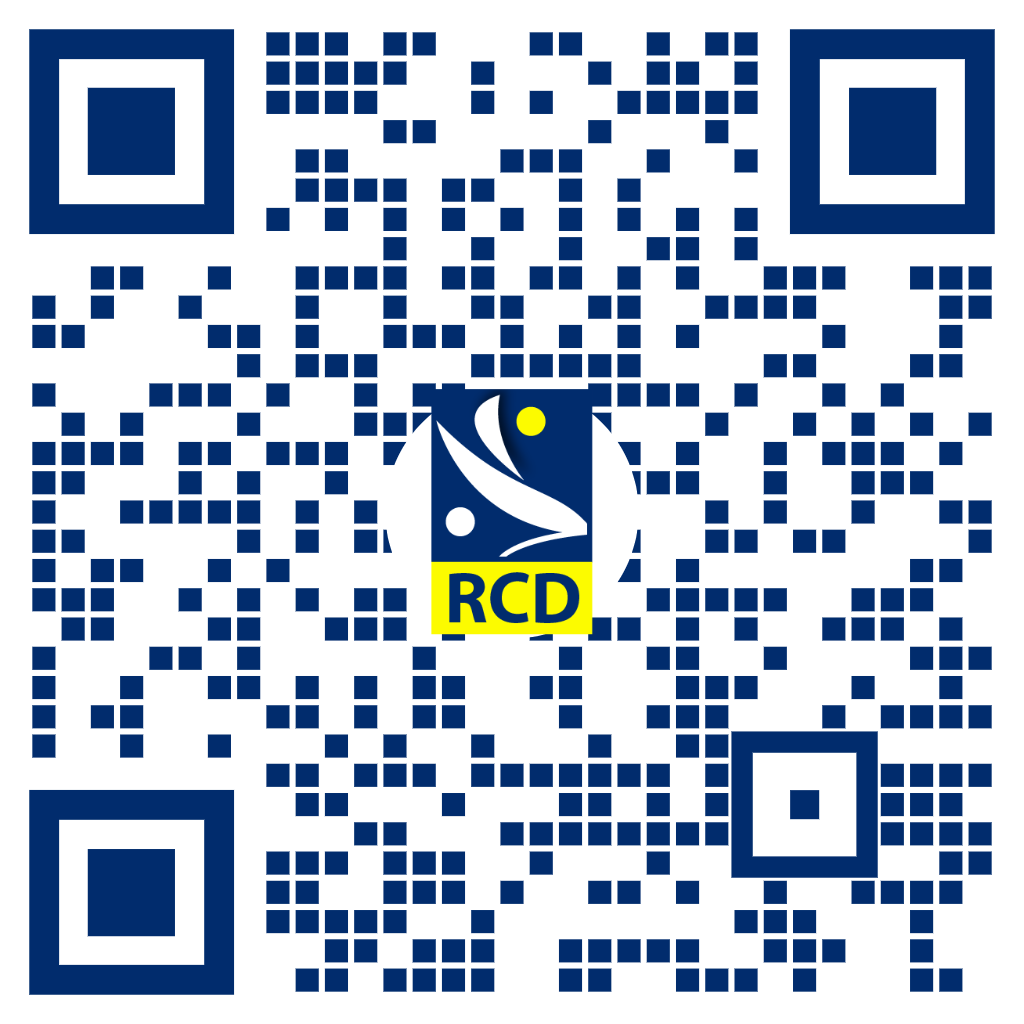Dans le tumulte des arbitrages budgétaires et des priorités nationales, Béjaïa semble reléguée, condamnée à une invisibilité persistante, voire entretenue. Malgré un potentiel exceptionnel, les infrastructures majeures — le port, l’aéroport et le téléphérique — qui dessinent un triangle stratégique capable de transformer la wilaya en un levier régional de développement intégré, durable et intelligent, souffrent de retards et d’incohérences. L’État national la considère trop souvent comme un simple point de passage, au lieu de l’intégrer pleinement dans une vision globale et équitable d’aménagement du territoire.
Un port stratégique sous-exploité
Le port de Béjaïa, l’un des plus importants ports du pays, notamment pour le trafic pétrolier, reste structurellement sous-dimensionné. Son tirant d’eau limité empêche l’accueil de navires de dernière génération et réduit son attractivité auprès des grands opérateurs logistiques. Pourtant, une étude technique datant de plusieurs années propose une extension offshore portant la profondeur à 16–17 m et la création de 1 200 m linéaires de quai, soit une augmentation de 50 % du linéaire actuel. Ce projet permettrait de gagner un temps considérable dans l’accueil des navires et de réduire significativement les frais de surestaries. Sa concrétisation, associée à une zone logistique connectée aux pôles économiques de l’arrière-pays, positionnerait Béjaïa comme un maillon essentiel du commerce méditerranéen.
Un aéroport au potentiel négligé
L’aéroport Soummam–Abane Ramdane, quant à lui, ne répond plus aux normes actuelles ni aux besoins croissants des usagers. Ses installations sont dépassées, sa connectivité réduite, et ses perspectives de développement négligées. Or, l’axe Béjaïa–Sétif constitue un corridor dynamique qui justifierait la transformation de cet aéroport en hub régional. Le projet clé consiste à prolonger la piste côté mer de 600 m, pour atteindre 3 200 m au total. Bien que la configuration naturelle — entre mer et montagne — complique les travaux, ce prolongement permettrait l’accueil de gros porteurs et renforcerait le rôle stratégique de l’aéroport.
Des connexions routières à fluidifier
Les connexions routières doivent également être optimisées pour démultiplier l’impact de ces infrastructures. Il conviendrait, par exemple, de créer une liaison directe entre la RN 12 et la RN 9, depuis Bir Slam jusqu’au niveau du marché de gros et de la cité universitaire, afin de désengorger le nœud des « Quatre Chemins ». La construction d’un autopont au carrefour jouxtant le site Sonatrach supprimerait le conflit entre les flux sortants du port vers l’est de la wilaya et ceux entrants vers le centre-ville, résorbant ainsi des embouteillages chroniques.
Dédoublement vital de la RN 9
L’urgence du dédoublement de la RN 9, notamment dans son tronçon reliant Béjaïa à Kherrata puis vers l’intérieur du pays, s’impose comme une nécessité vitale. Cette route, à fort trafic, devient un goulet d’étranglement permanent qui freine non seulement la mobilité des personnes mais aussi la fluidité des échanges économiques. Son élargissement doit devenir une priorité nationale.
Réhabiliter les routes rurales et communales
Par ailleurs, les chemins communaux, qui assurent l’interface entre les villages enclavés et les grands axes structurants, sont dans un état de délabrement avancé. Leur réhabilitation — aussi bien en termes de revêtement que de sécurisation — est cruciale pour le désenclavement réel des zones rurales et montagneuses, dont le dynamisme est souvent ignoré. Ces réseaux dits « secondaires » sont en réalité des leviers essentiels d’intégration territoriale.
Désenclaver le centre par le nord-ouest
Le raccordement de Bir Slam au pôle de Sidi Boudraham, puis au CET de Béjaïa, ouvrirait une nouvelle voie vers le chemin de wilaya reliant Toudja à Béjaïa (via le village du PK 17), désenclavant durablement le centre-ville, notamment le tronçon Aamriw–Ighil El Bourdj.
Le téléphérique, symbole d’un retard structurel
Le projet de téléphérique incarne le retard chronique de Béjaïa. Approuvé, budgétisé et annoncé depuis des années, il demeure à l’état de promesse non tenue. Pourtant, dans une ville au relief accidenté et à la circulation saturée, ce mode de transport offrirait des avantages majeurs : fluidifier la mobilité entre le centre et les quartiers périphériques, désenclaver certaines zones densément peuplées et constituer un atout touristique. L’urgence est d’autant plus grande que, en 2025, Béjaïa ne dispose d’aucun parking en infrastructure — une carence particulièrement criante durant la saison estivale, lorsque l’afflux de visiteurs (nationaux et issus de la diaspora) aggrave la congestion. La réalisation du téléphérique doit s’inscrire dans un plan global de mobilité urbaine durable, intégrant des transports collectifs modernes, des aires de stationnement structurées et des liaisons fluides vers les zones industrielles.
Pour une reconnaissance équitable et une volonté politique claire
Ce que Béjaïa réclame, ce n’est pas un geste de faveur, mais un traitement équitable à la hauteur de ses atouts géographiques et naturels. Les projets existent, les besoins sont cernés, les études sont disponibles. Ce qui manque, c’est une volonté politique claire, un calendrier d’exécution crédible et la reconnaissance du rôle que cette wilaya peut jouer dans l’équilibre national.
SNAT, gouvernance territoriale et libération des initiatives
Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) est l’outil idoine pour dynamiser l’activité économique : il reste à donner vie aux régions qu’il préconise, à renforcer les synergies territoriales et à favoriser une gouvernance plus territorialisée. Mais pour y parvenir, il faut sortir du dogme du contrôle centralisé, libérer les initiatives locales, responsabiliser les élus et diversifier les sources de financement.
Nora Ouali Secrétaire Nationale du RCD.